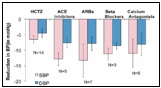LÕHYPERTENSION ARTERIELLE REFRACTAIRE
DÕaprs un expos du Dr Vronique Dormagen
Cardiologue Chef de Ple GHEM Hpital Simone Veil Eaubonne
DPC du 10 janvier 2013
1. GNRALITS
1.1. FLASH 2012(French League Against Hypertension
Survey)
1.1.1. Principe
CÕest une enqute ralise tous les 2 ans depuis 10 ans en France et portant sur 3462 personnes de plus de 35 ans remplissant un auto-questionnaire, recopiant leur ordonnance et donnant le relev dÕautomesures (3 mesures 1 le matin) pour 722 personnes.
1.1.2. Rsultats
1.1.2.1. Traits
30 % des personnes interroges ont dclar prendre un traitement anti HTA ce qui, en extrapolant, reprsenterait 11,4 millions de personnes hypertendues en France. De plus, 10% dÕentre elles ont une HTA non traite ce qui ajouterait encore 4 millions de personnes.
15
millions dÕhypertendus en FranceÉ
1.1.2.2. Equilibrs
50 % des patients traits sont quilibrs (moyenne de jour MAPA < 135/85 mmHg), valeurs stables, aprs forte progression 2002-2008 (24 % des patients actifs ; 76 % des patients retraits) infrieurs aux taux observs aux USA, 75-80 %.
7,5
millions dÕhypertendus quilibrs en FranceÉ
1.1.2.3. Observance
56% des patients se disent bons observants (80% dÕobservance) ; 34% disent avoir des problmes mineurs dÕobservance, enfin 5% ont des problmes importants.
1.1.2.4. Les enseignementsÉ
Ce sont ces 50 % dÕhypertendus traits non quilibrsÉ mme sÕils ne rpondent pas tous la dfinition retenue par les socits savantes et donc 15 % de la population adulte franaise !
LÕHTA est le motif de 17% des consultations de MG en France et 34 % pour les plus de 71 ans (enqute DREES 2002-2004), et pourtant É
- Annulation des recommandations HAS 2005 pour cause de conflit dÕintrt, sans nouvelle recommandations depuis (contrastant avec nombreuses mises jour lÕtranger, et en particulier en Angleterre : NICE http://guidance.nice.org.uk/CG127)
- Suppression en 2011 de lÕHTA svre de la liste des maladies prises en charge 100 % par SS
DÕo raction de la communaut franaise spcialise en HTA, qui a propos ses propres recommandations en dcembre 2012.
De plus lÕinitiative Ç OBJECTIF 2015 È destination des mdecins, publi par SFHTA et le Comit de lutte contre HTA, vise obtenir en 2015 quÕau moins 70 % dÕhypertendus traits soient quilibrs.
1.2. QuÕest-ce que lÕHTA rsistante
1.2.1. Dfinitions
Selon les recommandations de la Socit Europenne dÕHTA, lÕHTA rsistante, encore appele HTA rfractaire, est dfinie par des chiffres de pression artrielle (PA) suprieurs 140/90 mmHg lors de deux consultations successives (2 mesures par consultation) malgr une trithrapie synergique, comportant un diurtique prescrit dose optimale, pendant une priode dÕau moins 6 semaines.
Ç Objectif
tensionnel non atteint malgr mesures hygino
dittiques et triple thrapie dont au moins 1 diurtique thiazidique È
LÕobtention dÕun quilibre tensionnel adquat (objectif < 140/90 mmHg) ncessite au moins deux mdicaments chez plus de la moiti des patients. Ce nÕest quÕ partir de trois mdicaments que lÕon parlera dÕhypertension rfractaire.
Les mdicaments utiliss doivent appartenir des classes thrapeutiques diffrentes agissant en bonne synergie. De manire gnrale, lÕassociation dÕun mdicament agissant sur lÕexcs de volume (antagoniste calcique, diurtique) avec un mdicament agissant sur les rsistances vasculaires : inhibiteur de lÕenzyme de conversion, sartan voire un btabloquant.
1.2.2. PRVALENCE DE LÕHTA RSISTANTE
1.2.2.1. Ce que disent les tudesÉ
LÕtude NHANES de 2011
Aux USA les chiffres pour la priode 2003-2008, 12,8% des HTA traites avec plus de 3 molcules. Les comorbidits sont : lÕge, un IMC lev, DFG, un diabte, des antcdents, dÕAVC, dÕIDM ou dÕIC.
1.2.2.2. LÕtude publie par Circulation en 2012
CÕest une tude rtrospective portant sur 205 750 hypertendus traits. Les critres retenu pour dfinir lÕHTA rsistante taient : HTA non quilibre sous au moins 3 mdicaments ou quilibre sous au moins 4, et, enfin, au moins 80 % dÕobservance.
Les rsultats donnent un taux de rsistance 1,9 % 18 mois. Les facteurs associs taient : lÕge, lÕexistence dÕun diabte, un traitement comprenant des btabloqueurs, des inhibiteurs calciques et des alpha-bloqueurs.
Dans ce cas cÕest 18% de complications cardiovasculaires versus 13,5% si lÕHTA est quilibre.
1.2.2.3. Equipe HEGP (Pr Girerd)
La cohorte est base sur 796 patients adresss pour HTA Ç rsistante È. Aprs optimisation du traitement :
á 13,6% restent rsistants sous 3 mdicaments
á 3,6 % restent rsistants sous 4 mdicaments
á 2,1% restent rsistants sous 4 mdicaments dont la spironolactone, soit 17 patients
LorsquÔelle est confirme, lÕHTA rsistante nÕest pas neutre en termes de complications vasculaires car, dans cette srie, on observe 35% de complications cardiovasculaires.
1.2.2.4. Quelques pistesÉ
La non-rponse au traitement antihypertenseur est souvent lie une rtention hydrosode, mme sub-clinique.
tant donn la difficult dÕobtenir une restriction sode chez beaucoup de patients, la prescription dÕun diurtique sera souvent ncessaire pour atteindre lÕobjectif tensionnel. On choisira un diurtique thiazidique si la fonction rnale est normale ou lgrement altre, un diurtique de lÕanse en cas de clairance < 30 ml/min.
Enfin, des travaux rcents ont montr lÕintrt de lÕadjonction de spironolactone faible dose en cas dÕhypertension difficile contrler, quÕil y ait ou non un hyperaldostronisme associ.
LÕabsence de contrle adquat de lÕhypertension est bien souvent due une inertie thrapeutique du mdecin qui rpugne ajouter un mdicament ou en augmenter la dose, en particulier pour les diurtiques.
2. La dmarche diagnostique
2.1. Globalement des diffrentes tapes
Pour le mdecin gnraliste : affirmer la rsistance
au traitement.
1. liminer une pseudo-HTA ?
2. Prciser lÕeffet blouse blanche ? LÕHTA est-elle permanente ?
3. Dterminer le niveau dÕobservance,
4. liminer des interactions mdicamenteuses dltres ; quid de lÕalcool et du sel ?
5. Dterminer lÕexistence ventuelle de situations cliniques particulires
6. Le traitement est-il optimal ? Tous les traitements se valent ils ?
Au terme de cette dmarche, le recours une consultation
spcialise est ncessaireÉ
1. liminer une HTA secondaire
2. Envisager lÕintroduction de la spironolactone
3. En dernier recours, dans des cas trs prcis discuter une dnervation rnale
2.2. Affirmer la rsistance au traitement est une tape majeure de la prise en chargeÉ
2.2.1. HTA Ç artificiellement fabriques È
Une majoration des chiffres peut tre observe dans de nombreuses circonstances :
á Le brassard est trop petit (la poche gonflable doit couvrir au moins les 2/3 du bras) ; au quotidien, il faudrait disposer de 3 tailles de brassard
á Le brassard est positionn plus bas que le cÏur, sÕil est trop serr
á En cas de raction dÕalarme, lÕabsence de repos É
En cas dÕasymtrie tensionnelle, il faut prendre en compte le chiffre le plus lev
Il existe, en plus, des difficults dÕinterprtation par rapport aux objectifs tensionnels, tout particulirement pour les patients de moins de 80 ans, y compris les diabtiques et les insuffisants rnaux (sauf cas particuliers de progression ou de complications).
Au-del de 80 ans, lÕobjectif est de < 150/90 mmHg.
2.2.2. VARIABILIT TENSIONNELLE
2.2.2.1. CÕest un problme quotidien
Il est responsable du non changement de traitement en dpit de chiffres tensionnels levs dans 50 % des consultations (enqute PARITE auprs de cardiologues). Elle est responsable en partie de lÕinobservance et de lÕinertie mdicale car Ç les chiffres ne sont jamais pareils È, Ç on ne peut rien dduire des chiffres en consultation ÈÉ
A lÕchelon individuel, la variabilit TA entre 2 consultations peut tre plus importante que lÕeffet attendu du traitement. Le seul moyen de rduire la variabilit tensionnelle est de multiplier les mesuresÉ
Ce problme est repris par la mta-analyse du BMJ publie en 2011 comparant la mesure clinique de TA, lÕautomesure et la MAPA et portant sur 5860 patients (48 ans en moyenne). Il en ressort que la mthode de rfrence est la MAPA et que la moyenne de jour doit tre > 135/85 mmHg.
|
Prvalence HTA |
VPP mesure clinique |
VPP automesure |
VPN mesure clinique |
VPN automesure |
|
10 % |
19 % |
25 % |
97 % |
96 % |
|
30 % |
47 % |
56 % |
90 % |
87 % |
|
50 % |
67 % |
75 % |
80 % |
75 % |
Toutes les recommandations rcentes insistent ainsi sur la ncessit des mesures ralises en dehors du cabinet, avant de dfinir une HTA rsistanteÉ
Entre la MAPA et lÕautomesure, Il existe des discordances assez nombreuses, surtout pour les valeurs tensionnelles proches des seuils. Les recommandations trangres privilgient la MAPA (NICE 2011, Australie 2012). En France recommandations de la SFHTA 2012 sont en faveur de lÕautomesure en raison des limitations de la MAPA :
á LÕaccessibilit de la MAPA et la non-cotation CAM
á La tolrance imparfaite par les patients (2 dplacements, et dsagrable)
LÕautomesure a une valeur ducative et favorise.
2.2.2.2. LÕautomesure
Il y a environ 7 millions dÕappareils dÕautomesure, dont 4 millions chez des hypertendus traits. Les enqutes rvlent que lÕautomesure est le plus souvent mal utilise et quÕune ducation thrapeutique est ncessaire (site www.automesure.com).
Il faut, si possible, conseiller achat de brassard humral et valid. Si le brassard est radial, il faut montrer le positionnement du brassard, et du bras, de prendre une bonne position (assis dos adoss; bras dnud et pos, dtendu; sans bouger ni parler), aprs repos de 5 mn.
Il faut faire plusieurs mesures :
Le matin avant petit djeuner, et le soir aprs le diner
3 fois de suite 1 minute dÕintervalle, matin et soir, 3 jours de suite (recommandations France), avant consultation, 1 fois / mois si HTA non quilibre, puis tous les 3 6 mois Rgle des 3 18 mesures consigner sur un document rapporter lors de la consultation.
Il est important de prciser lÕobjectif atteindre : une moyenne tensionnelle < 135/85 mmHg
2.2.2.3. Les limites de lÕautomesure
LÕautomesure est inadapte pour
- Les sujets anxieux
- Les obses (circonfrence du bras > 32 cm)
- Femme enceinte et enfants (mthode non valide)
- En cas dÕACFA (mesures alatoires)
- En cas de troubles cognitifsÉ.
- Les patients incapables de respecter la rgle des 3, soit une grosse majorit au quotidien !
La consquence est la ncessit dÕun recours la MAPA trs souvent (recommandations SFHTA 2012)
- Lorsque lÕautomesure est impossible
- SÕil existe une discordance entre mesure au cabinet et automesure
- Pour la recherche dÕHTA masque (atteinte organes cibles)
- En cas de suspicion dÕhypotension artrielle
Rappel des normes tensionnelles en dehors du cabinet
|
Automesure
(mmHg) |
MAPA
(mmHg) |
|
Moyenne
de 18 prises < 135/85 |
Moyenne des 24 h < 130 /
80 Moyenne de jour < 135 /
85 Moyenne de nuit < 120 / 80 |
2.2.3. LÕobservance
La mauvaise observance du traitement serait responsable de 50 % des HTA paraissant rsistantesÉ
2.2.3.1. Dfinition
CÕest la bonne concordance entre les prescriptions/recommandations et le comportement du patient concernant le suivi de la prescription mdicamenteuse (horaire, doses, dureÉ), des rgles hygino-dittiques, et du suivi mdical.
Un patient est dit Ç bon observant È sÕil prend 80% du traitement correctement.
1/3 bonne observance, 1/3
observance partielle, 1/3 mauvaise observance
Les facteurs favorisant la non-observance associent le faible niveau socio-conomique, la qualit de la relation mdecin-patient, le suivi mdical irrgulier, lÕchec du traitement ou sa mauvaise tolrance, le dni de la maladie.
2.2.3.2. Dans une tude rtrospective sur 4087 patients
Elle reprenait diffrentes tudes de phase 4 de traitement antihypertenseur (BMJ 2008) ; 2088 ARA2, 937 ICa, 665 IEC, 195 BB, 135 DIU) avec suivi de lÕobservance par pilulier lectronique, 2 composantes de lÕobservance ont t tudies :
á Persistance : temps pendant lequel le traitement est pris
á Qualit dÕexcution du traitement, au quotidien
Les rsultats montrent que 50% des traitements sont arrts 1 an et 10% des doses non prises quand le traitement est poursuivi. De plus :
á 95% oublient 1 dose (30 heures) au moins 1 fois dans lÕanne
á 50% oublient 1 dose au moins 1 fois par mois
á 48% font une pause dÕau moins 3 jours au moins 1 fois par an
á 13% font une pause dÕau moins 3 jours au moins 6 fois par an
LÕinobservance augmente avec le nombre de prises de mdicaments. Elle dpend aussi de lÕheure de prise, lÕobservance le matin tant meilleure.
2.2.3.3. valuer lÕobservance
CÕest difficile mais indispensable pour le reprage des mauvais observants. Il nÕy a pas de mthode de rfrence mais le Comit de lutte contre HTA recommande le questionnaire suivant
1. Ce matin, avez-vous oubli de prendre votre mdicament ?
2. Depuis la dernire consultation, avez-vous t en panne de mdicament ?
3. Vous est-il arriv de prendre votre traitement avec retard par rapport lÕheure habituelle ?
4. Vous est-il arriv de ne pas prendre votre traitement parce que certains jours votre mmoire vous fait dfaut ?
5. Vous est-il arriv de ne pas prendre votre traitement parce que certains jours vous avez lÕimpression que votre traitement vous fait plus de mal que de bien ?
6. Pensez-vous que vous avez trop de comprims prendre ?
(0 oui
= bonne observance, 1 2 oui = minime problme dÕobservance, ³ 3 oui =
mauvaise observance)
Il est plus facile de reprer les facteurs prdictifs de mauvaise observance
á Niveau socio culturel trs bas +++
á Handicap, dpendance, troubles psy ou cognitifs
á Facteurs psycho-sociaux : accs aux soins, solitude, dpression, erreurs de mode de vie : dittique, tabagisme, thylisme...
á Niveau dÕinformation sur maladie, traitementÉ
á Prjugs et craintes vis vis du mdicament (fausses croyances)
2.2.3.4. Amliorer lÕobservance
Il faut tre conscient du risque dÕinobservance et en parler chaque consultation.
Il est important dÕidentifier prcocement les inobservants car ce sont eux qui vont arrter leur traitement. Il faut reprer les patients risque et voquer les situations Ç risque È, week-ends et congs.
Il est important
á De simplifier le traitement : 1 prise quotidienne, le matin (+ schma adapt aux habitudes du patient)
á De choisir des mdicaments les mieux tolrs et adapts au patient (galnique, gotÉ)
á De prfrer les mdicaments ½ vie longue, et si besoin la prescription dÕassociations fixes
á DÕinformer sur les effets secondaires
á De ne pas occulter les problmes des gnriques, en gnral plus prompts induire une non-observance.
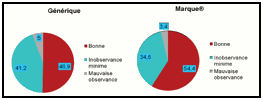
95%
oublient 1 dose (30 heures) au moins 1 fois dans lÕanne
50%
oublient 1 dose au moins 1 fois par mois
48%
font une pause dÕau moins 3 jours au moins 1 fois par an
13%
font une pause dÕau moins 3 jours au moins 6 fois par an
2.2.4. Consultation dÕannonce du diagnostic DÕHTA
CÕest le mme principe que lÕannonce en cancrologie qui doit se faire au cours dÕune consultation longue. Selon une prconisation de la SFHTA (2012), elle serait faite par le mdecin gnraliste avec les objectifs suivant proposs par la
1. Dfinition de lÕhypertension artrielle
2. Origine de lÕhypertension artrielle
3. Consquences de lÕhypertension artrielle
4. Rversibilit du risque attribuable
5. Moyens thrapeutiques
6. Schmas thrapeutiques
7. Temporalit
8. Objectifs
9. Balance dcisionnelle (bnfices/risques, avantages/inconvnients)
10. Approfondissement : renforcement de motivation partir des rflexions du patient au cours de lÕentretien : insister sur le risque pour ce patient (ressenti de menace) et sur les bnfices potentiels pour ce patient
2.2.5. Les causes iatrognes
Il convient de vrifier quÕil nÕy ait pas de mdications qui limitent lÕefficacit du traitement antihypertenseur. Les principales sont :
á LÕalcool ++++ n¡ 1 en France
á Les Ïstrognes ++ de faon dose dpendante
á Tous AINS +++ y compris les OTC et lÕapplication locale si large et rpte
á Inhibiteur de recapture de srotonine et noradrnaline (Effexorª, Ixelª)
á Paractamol effervescent forte dose (380 mg de Na par comprim)
á Corticodes, cyclosporine, EPO
á Cocane amphtamines
á Sympathomimtiques et rglisse rarement
á Inducteurs enzymatiques
2.2.6. Le sel
Le lien entre HTA et consommation de sel reste controvers, mme si une consommation excessive de sel est un facteur de rsistance en raison dÕune hypervolmie et dÕune moins bonne efficacit des traitements. Chez lÕhypertendu, il faut rduire la consommation de sel, idalement aux alentours de 5 g de NaCl / jour, alors que bien quÕen baisse, la consommation moyenne en France en 2011 est de 10 g chez les hommes et de 8 g chez les femmes.
Pour un patient, la quantification est possible mais difficile par natriurse des 24h.
|
Le
sel au quotidien en France |
|
á Sel rajout sur la table et pendant cuisson á Pain, charcuterie, condiments et sauces á Plats cuisins et pizzas, fromages, soupes á Mconnaissance par les patients á 1 g de sel = 1 tranche de saucisson = 1 poigne de chips = 1 part de pizza = 4 tranches de painÉ |
En pratique il faut demander, au moins, la suppression de la salire et de la charcuterieÉ
2.2.7. Dterminer lÕexistence ventuelle de situations cliniques particulires
2.2.7.1. HTA & obsit
LÕobsit multiplie par 6 le risque dÕHTA par activation du SRAA et du systme sympathique. De plus, lÕobsit abdominale (graisse brune) majore le risque cardiovasculaire par un effet pro inflammatoire.
Chaque 10 kg de poids augmente de 3 mmHg la PAS ! La surcharge pondrale est un dterminant majeur de 2/3 des HTA.
Il existe une relation linaire entre perte de poids et TA mais la diminution reste modeste. Cependant, la perte de poids est indispensable, surtout pour le contrle des autres facteurs de risque cardiovasculaires.
Il nÕy a pas de traitement spcifique. Il faut viter en 1re intention (sauf besoin spcifique), les thiazidiques, en raison de leur effet diabtogne et les btabloquants qui limitent la baisse de poids. Il faut favoriser les IEC/sartan en raison de la diminution du risque dÕapparition dÕun nouveau diabte et aussi de favoriser association IEC/sartan + inhibiteur calcique (tude ACCOMPLISH : IMC moyen 31).
|
tude
ALLHAT IMC moyen 30 % diabte
4 ans |
Prsence
dÕun syndrome mtabolique |
Absence de
syndrome mtabolique |
|
Thiazidique |
7,7 |
17,1 |
|
IEC |
4,7 |
12,6 |
|
Dihydropyridine |
4,2 |
16 |
2.2.7.2. Le syndrome dÕapne du sommeil (SAS)
Il sÕagit dÕun facteur aggravant reconnu dÕHTA. Cette situation clinique reste insuffisamment dpiste alors quÕelle concernerait environ 2 4 hypertendus obses sur 10.
Il est frquemment associ une obsit, une insulinorsistance, des facteurs associs de rsistance au traitement (60 % de SAS sur une srie de 125 patients explors pour HTA rsistante). Les lments vocateurs sont :
á HTA souvent masque
á Une lvation plus marque sur PA diastolique
á HTA souvent nocturne
á Pas de diminution nocturne en MAPA (non-dipper)
Il est donc recommand de raliser un enregistrement du sommeil en cas dÕHTA rsistante et de terrain vocateur.
Les apnes, par lÕhypoxie-hypercapnie, induisent une stimulation du systme nerveux sympathique, une lvation des rsistances vasculaires priphriques, une hypertension prdominance nocturne et une diminution de lÕefficacit du traitement.
LÕefficacit de la CPAP sur lÕHTA est cependant controverse. CÕest la perte de poids qui va tre un objectif prioritaire du traitement
2.2.7.3. HTA du sujet trs g
Ce que lÕon saitÉ
Le traitement bnficie aux patients gs de plus de 80 ans comme lÕa montr lÕtude HYVET (indapamide ± perindopril). Les limites de cette tude taient quÕelle portait sur une population en bon tat gnral, non institutionnalise et avec peu de comorbidits. Ces rsultats contrastent avec augmentation de mortalit dans mta analyse pralable.
Les recommandations chez sujet g
Elles sont :
á De toujours rechercher une hypotension orthostatique et un effet blouse blanche
á DÕavoir pour objectif < 150/90 mmHg (ou diminution de 20 mmHg pour la systolique), en se basant plutt sur TA debout
á DÕutiliser au maximum 3 mdicaments sans hypotension orthostatique en vitant les IEC et les sartans.
á DÕviter le rgime sans sel
á De donner des conseils pratiques comme
o De prvoir des bas de contention,
o De recommander de croiser les jambes avant de se lever,
o De dormir ½ assis et de dcomposer le lever.
2.2.7.4.
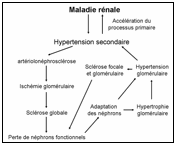 LÕinsuffisance rnale est un facteur de rsistance
LÕinsuffisance rnale est un facteur de rsistance
LÕaide du nphrologue est indispensable. Le bilan comporte une imagerie rnale pour estimer la taille des reins et rechercher une stnose artrielle selon terrain (avis nphrologue)
Si clearance cratinine < 30 ml/mn, cÕest une contre-indication aux thiazidiques et la spironolactone et une indication utiliser les diurtiques de lÕanse (Lasilixª, Burinexª, gnriques). Il faut adapter doses dÕIEC/sartan. La place des inhibiteurs calciques, des centraux, des btabloquants dpendra du terrain.
2.2.8. Le traitement est-il optimal ?
2.2.8.1. Tous les traitements se valent ils ?
Il faut se souvenir que lÕutilisation des ARA2 est associe la plus longue persistance de traitement sur le long terme, du fait dÕune bonne tolrance.
Au sein dÕune mme classe, lÕefficacit dpend aussi de la dure dÕactionÉ
|
|
|
2.2.8.2. Tous les thiazidiques se valent ils ?
LÕhydrochlorothiazide est moins efficace que lÕindapamide. La rduction de risque dÕvnements cardiovasculaires sous chlortalidone est plus rapide que sous HCTZ= 18
En cas dÕHTA rsistante, on peut envisager :
á Une augmentation de lÕhydrochlorothiazide (au moins 25 mg)
á Un changement de thiazidique (indapamide, altizide, chlortalidone)
2.2.8.3. Au quotidien, le traitement optimal comprend:
Il comprend les mdicaments suivants :
á 1 Bloqueur du systme rnine angiotensine (BSRA) en monoprise et demi vie longue
- Associ un inhibiteur calcique en monoprise et demi vie longue
- Idalement en association avec un diurtique thiazidique : 25 mg de HCTZ ou indapamide
On attend la triple association dans 1 seul comprim et rembourse par SS.
2.3. Au terme de cette dmarche, le recours une consultation spcialise est ncessaireÉ
2.3.1. Dans une minorit de cas, lÕexistence dÕune hypertension secondaire
Il faut la rechercher une HTA secondaire quand lÕHTA est rellement rsistante au terme de la dmarche dcrite plus haut ou, avant, sÕil existe des lments dÕorientation comme :
- HTA < 40 ans
- HTA svre dÕemble (> 18/11 ou sÕaggravant rapidement)
- Hypokalimie < 3,5 (ou 3,7 sous BSRA)
- Majoration de plus de 30% de la cratininmie sous BSRA
Les causes plus frquentes dans ce cas sont :
á Les hyperaldostronismes
á Les maladies rnales (insuffisance rnale +++, stnose artre rnale)
o Nphropathies parenchymateuses (majoration de la cratinine plasmatique, anomalies du sdiment, protinurie leve)
o Nphropathies vasculaires (stnoses athromateuses des artres rnales chez le patient g, polyvasculaire, prsentant plusieurs facteurs de risque ou plus rarement dysplasie fibromusculaire chez la jeune femme).
á Le phochromocytome trs rare
|
Facteurs favorisant la rsistance au
traitement antihypertenseur |
|
¥ Hyperaldostronisme o Primaire : Conn, hyperplasie bilatrale des surrnales o Secondaire : stnose artrielle rnale, tumeur rnine ¥ Nphropathies ¥ Phochromocytome ¥ Hypercorticisme ¥ Dysthyrodie ¥ Coarctation aortique |
Kalimie et cratinine systmatiques ; angioscanner rnal et surrnal Ç facile È
2.3.1.1. LÕhyperaldostronisme primaire
Il est le plus souvent d lÕexistence dÕune hyperplasie surrnalienne, plus rarement un adnome de Conn (intrt du rapport aldostrone/activit rnine plasmatique pour le dpistage). Cette affection est nettement plus frquente en cas dÕhypertension svre ou rfractaire et, contrairement une vieille ide, nÕest associe une hypokalimie que dans une minorit de cas.
Il faut aussi penser au syndrome de Cushing (obsit tronculaire, visage lunaire, faiblesse musculaire.
2.3.1.2. Stnose dÕartre rnale athromateuse
CÕest 7 % des HTA de plus de 65 ansÉ
Six grands essais montrent lÕabsence de supriorit de lÕangioplastie rnale par rapport au traitement mdical sur les chiffres tensionnels. En particulier, il nÕy a pas de normalisation tensionnelle aprs angioplastie de SAR athromateuseÉ
Le risque cardiovasculaire de ces patients est trs lev et lÕessentiel rside dans la prise en charge du risque cardiovasculaire par
á Les BSRA (diminution du risque de dialyse)
á Les antiagrgants, les statines
Quand rechercher une stnose dÕartre rnale ?
Dans un cas de figure, il sÕagit dÕune HTA du sujet jeune en rapport avec des stnoses fibrodysplasiques, dans 1 % de cas dont le traitement est la dilatation.
LÕautre cas de figure est un terrain athromateux associ une HTA Ç vraiment È rsistante, et/ou majoration de la cratininmie, en particulier sous BSRA. LÕIndication de dilatation sera porte sur des critres rnaux, diminution de taille de rein, diminution de filtration glomrulaire.
2.3.1.3. Phochromocytome
CÕest trs rare mais trs grave (malignit). )
Classiquement, il existe des pics tensionnels et une triade de cphales, sudations et palpitations.
Il ne faut pas passer ct et doser les mtanphrines + normtanphrines sur les urines de 24 h
Peu dÕinterfrences mdicamenteuses
2.3.2. Ajout spironolactone si HTA rsistante
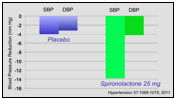 CÕest une
option intressante au-del de la tri-thrapie. La
posologie de spironolactone ne doit pas dpasser 25 mg / jour.
CÕest une
option intressante au-del de la tri-thrapie. La
posologie de spironolactone ne doit pas dpasser 25 mg / jour.
Dans ce contexte, il faut imprativement viter hyperkalimie et les effets secondaires.
Tout dÕabord il existe une contre-indication en cas dÕinsuffisance rnale. Il faut surveiller la kalimie +++, trs rgulirement en particulier en cas dÕassociation avec les BSRA.
ventuellement, on peut la prescrire sous forme dÕAldactazineª (25 mg spironolactone + 15 mg altizide : diurtique plus efficace que HCTZ).
LÕInspraª (plrnone) nÕa pas dÕAMM pour lÕindication HTA. Elle est 3 fois moins efficace que spironolactone comme lÕont mont les tudes Ç SIMPLICITY È :
- Efficacit limite sur chiffres tensionnels
- Pas dÕtude de morbimortalit
- Quelques complications
2.3.3. La dnervation rnale par voie endovasculaire
2.3.3.1. Contexte
Historiquement, la dnervation rnale chirurgicale a t pratique grande chelle chez les hypertendus svres et compliqus ds la fin des annes 1930, alors que le traitement mdicamenteux nÕexistait pas encore.
LÕintervention la plus courante consistait en une sympatho-splanchnicectomie dorsolombaire ou intervention de Smithwick, par rsection des ganglions sympathiques de D8 L1 (au maximum de D6 L3) et des nerfs splanchniques destins au ganglion cÏliaque. La procdure tait particulirement invasive, parfois ralise en deux temps au cours dÕune hospitalisation de 15 jours et greve dÕune mortalit priopratoire de lÕordre de 5 %.
Les effets indsirables de cette dnervation complte et tendue taient nombreuses, invalidantes et durables (lombalgies, radiculagies, hypotension orthostatique, troubles sphinctriens et sexuels, hypersudation paradoxale).
La diminution de la TA tait inconstante, observe dans environ 50 % des cas.
LÕavnement de mdicaments antihypertenseurs dans les annes 1960 a fait abandonner cette chirurgie.
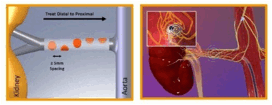 CÕest une mthode
nouvelle qui permet la destruction des fibres nerveuses sympathiques qui
cheminent dans lÕadventice des artres rnales. Une tude clinique randomise
(SIMPLICITY 2) a montr une baisse de la tension artrielle chez des patients
hypertendus rsistants aux mdicaments antihypertenseurs.
CÕest une mthode
nouvelle qui permet la destruction des fibres nerveuses sympathiques qui
cheminent dans lÕadventice des artres rnales. Une tude clinique randomise
(SIMPLICITY 2) a montr une baisse de la tension artrielle chez des patients
hypertendus rsistants aux mdicaments antihypertenseurs.
La dnervation rnale par radiofrquence applique par voie endovasculaire est une mthode qui ralise une destruction des fibres nerveuses priphriques qui engainent le tronc des artres rnales. Elle induit une diminution du tonus sympathique dÕorigine rnal avec une baisse de la pression artrielle.
2.3.3.2. Indication (runion de consensus)
Actuellement lÕindication la dnervation rnale devrait se limiter aux patients qui ont une HTA essentielle non contrle sous quadrithrapie ou plus avec un traitement comportant au moins un diurtique, la spironolactone la dose de 25 mg ayant t inefficace, avec au moins une tension artrielle systolique (TAS) > 160 mmHg et/ou une tension artrielle diastolique (TAD) > 100 mmHg en consultation et la confirmation dÕune TAS > 135 mmHg et dÕune TAD > 85 mmHg en automesure (ATM) ou par mesure ambulatoire de la pression artrielle (MAPA).
LÕanatomie des artres rnales doit tre compatible avec cette intervention
¥ 2 reins fonctionnels,
¥ Absence dÕantcdents dÕangioplastie
La dnervation rnale est une intervention complexe pouvant prsenter des risques de complication artrielle.
La technique de dnervation rnale ne peut sÕappliquer chez les patients hypertendus ayant :
á Une stnose dÕune artre rnale > 30 %.
á Une dysplasie fibromusculaire artrielle rnale
á Age de moins de 18 ans.
á Une grossesse en cours.
Complications lies la dnervation rnale : frquence infrieure 1 %
á -Douleurs abdominales pendant la procdure (qui seront attnues ou vites par lÕutilisation dÕantalgiques et/ou dÕanesthsiants)
á -Atteinte de la paroi artrielle lie la radiofrquence et/ou aux ultrasons (risque thorique).
á -Hypotension en particulier en position debout
á -Hmaturie
3. Conclusion
LÕHTA est une maladie difficile traiter car elle parait souvent Ç inconsistante È car :
á Elle est asymptomatique et trs fluctuante
á Les recommandations sont multiples
á Les mdicaments extrmement nombreux
En revanche, le bnfice du traitement est indiscutableÉ
Le traitement de lÕHTA rsistante passe par Ç la rsistance du mdecin È qui doit :
á duquer et motiver son patient
á Respecter les recommandations les plus rcentes (plurithrapie +++)
á Contrler la TA en dehors du cabinet,
LÕHTA rsistante est une affection rare puisquÕelle ne concerne que 5 10 % des HTA traits.
Une cause curable ne sera retrouve que chez 10 % dÕentre eux.
4. A lire le soirÉ
Recommandations 2012 de la SFHTA pour la prise en charge de lÕHTA de lÕadulte (www.sfhta.eu)
Recommandations 2011 de la SFHTA sur la mesure de la pression artrielle (www.sfhta.eu)
Rsum des recommandations anglaises 2011 du NICE (www.nice.org)
Le site : http://www.automesure.com/È
Le document Ç objectif 2015 È (www.sfhta.eu)
5. Rfrences gnrales
1.
ESH
guidelines for the management of HTN, J. Hypertens
2003;21:1011-53.
2. JNC7, Hypertension 2003;42:1206-52.
3. Vidt DG, Minerva Med 2003;94:201-14.
4. Vidt DG, Postgraduate Medicine 2000;107:57-70.
5. Kaplan NM, J. Hypertens 2005;23:1441-44.
6. Garg JP et al, Am J. Hypertens 2005;18:619-26.
7. Taler SJ, Curr Hypertens Rep 2005;7:323-9.
6. Rfrences spcifiques
1.
Laragh J, Am J Hypertens. 2001;14:491-503.
2.
Williams B
et al, BMJ 2004;328: 634-40.
3. Nishizaka MK et al, Curr Hypertens Rep 2005;7: 343-7.
4.
Belmin J et al, Am J
Med 1995;98: 42-9.
5. Logan AG et al, J. Hypertens 2001;19:2271-7.
6. Mosso L et al, Hypertension 2003;42:161-5.
7. Plouin PF et al, European Journal of Endocrinology 2004;151:305-8.
8. Taler SJ et al, Hypertension 2002;39:982-8.
9.
Pickering
TG et al, Curr Hypertens
Rep 1999;1:489-94.
10. Brown MA, Buddle ML, Martin A. Is resistant hypertension really resistant ? Am J Hypertens 2001;14: 1263-9.
11. Martell N, Rodriguez-Cerillo M, Grobee DE, et al. High prevalence of secondary hypertension and insulin resistance in patients with refractory hypertension. Blood Press 2003;12: 149-55