Actualits sur la BPCO
Dr Christian Delafosse,
Chef de service de Pneumologie -
Hpital Simone Veil – Eaubonne-Montmorency
Sance du 4 dcembre 2008
![]()
1.
Un
problemE majeur de sant publique
Les publications
scientifiques sur la BPCO se sont multiplies ces dernires annes, cela
plusieurs raisons.
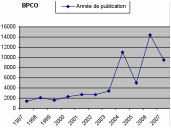
1.1.
aujourdÕhui
un problme de sant publique majeur.
On estime que :
á Elle touche actuellement 5 10% de la
population mondiale (4 6% en France).
Elle augmente de faon inquitante chez la femme.
á Seules 20 30% des BPCO sont
diagnostiqus !
Et 17% des bronchites chroniques diagnostique en France selon Similowski
Presse Med 2003 ;32 : 1403-9.
á Seuls 10 15% des BPCO sont pris en
charge !
á La morbidit et la mortalit sont
importantes.
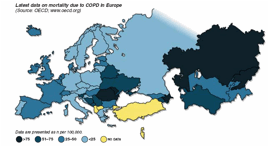
1.2.
demain
un des principaux problmes de sant publique mondial
á On estime que la mortalit par BPCO
augmentera dÕenviron 30% au cours des dix prochaines annes.
á Selon lÕOMS, la BPCO passera de la 6e
cause de mortalit mondiale la 3e place en 2020 !
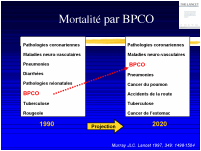
á Elle passera de la 12me cause
de morbidit la 5me place, dans le mme temps.
á Contrairement aux autres causes de
mortalits et notamment aux causes cardiovasculaires, la mortalit par BPCO
augmente rapidement (+163% entre 1965 et 1998).
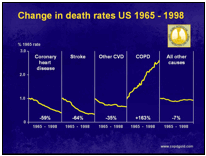
LÕhistoire de la
BPCO, de ses facteurs de risques, de son volution, de ses facteurs pronostics
et de sa prise en charge ont connus des avances remarquables ces dernires
annes.
2.
Facteurs
de risque
Le
tabagisme actif
reste le principal facteur de risque dans 80 90 % des cas (Risque relatif
[RR]=5,5 pour lÕhomme, RR= 7,7 pour la femme).
Le tabagisme
passif est un FdR ngligeable pour un individu, mais probablement notable pour
une population.
Les FdR
professionnels (silice, charbon, bryllium, cadmium, isocyanate, poussire de
coton) sont en baisse en France.
La pollution
principalement intrieure, semble avoir un rle notable. LÕutilisation de
combustible fossile au domicile (alimentation, chauffage) est un vrai problme
dans certaines rgions du monde et superposable la pauvret.
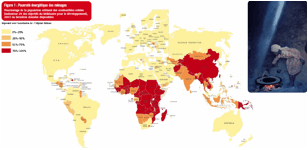
Fig. % de la population utilisant des
combustibles fossiles
3.
Diagnostic
Il repose sur la
conjonction de FdR, dÕune histoire vocatrice, de symptmes respiratoires
(dyspne dÕeffort, etc.), avec un stade avanc une distension thoracique
clinique et radiologique.
Les EFR
sont indispensables devant tout FdR ou signe vocateur. Elles permettent le
diagnostic et permettent dÕvaluer la svrit et le pronostic de la BPCO.
Elles permettent galement de dpister un emphysme associ et recherchent une
amlioration aprs bronchodilatateurs. Les gaz du sang permettent dÕvaluer un
retentissement sur lÕhmatose et le test de marche 6 minutes, un retentissement
sur lÕexercice.
La RP et les EFR
sont dÕindication large chez les fumeurs ou ex fumeurs.
Recommandations
du GOLD, ATS/ERS et SPLF ð EFR chez tout fumeur > 40 ans.
Les symptmes
sont de mauvais facteurs prdictifs de BPCO.
Dans plus de 20%
ils sont absents en cas de BPCO svre (VEMS < 50% de la thorique) !
4.
Histoire
naturelle de la BPCO
De nombreux
travaux ces dernires annes ont permis de mieux comprendre lÕhistoire
naturelle de la BPCO, son impact et ont amlior sa prise en charge.
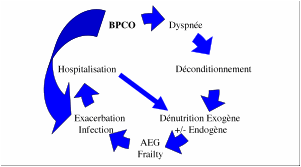
Il existe un
vritable cercle vicieux volutif de la BPCO.
Elle entrane une
dyspne qui aboutit une sdentarit et un dconditionnement musculaire,
avec dnutrition, altration de lÕtat gnral, favorisant des exacerbations,
une fois sur deux infectieuses.
Ces exacerbations
ont clairement montres leurs impacts ngatifs sur lÕaggravation de la maladie
court et long termes. Elles majorent encore (surtout sÕil elles
sÕaccompagnent dÕhospitalisations), la dnutrition et acclrent la spirale dÕaggravation.
5.
Pronostic
LÕvaluation du
pronostic des BPCO repose toujours sur le VEMS (valu par les EFR), mais plus
uniquement. Ainsi, lÕtude publie en 2004, dans le New England Journal of
Medicine, a montr tout lÕintrt dÕun index combin [index de BODE]
valuant lÕobstruction bronchique (VEMS), avec paralllement, lÕvaluation de
lÕindice de masse corporelle (IMC), de la dyspne du patient et sa tolrance
lÕexercice lors dÕun test de marche 6 minutes.
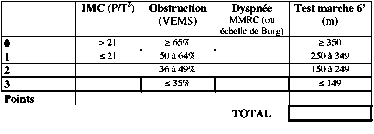
-
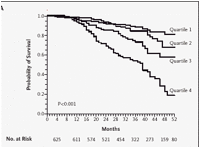 Quartile 1 : IBODE 0 2
Quartile 1 : IBODE 0 2
-
Quartile
2 : IBODE 3 5
-
Quartile
3 : IBODE 5 6
-
Quartile
4 : IBODE 7 10
CÕest aujourdÕhui
le meilleur indice pronostic valid.
6.
BPCO
= Maladie Gnrale
Un autre progrs
majeur sur la comprhension de la pathologie, qui a eu un impact efficace sur
la prise en charge, est de savoir aujourdÕhui que la BPCO nÕest pas quÕune
maladie broncho-pulmonaire, mais que cÕest une maladie gnrale !
6.1.
Inflammation
systmique
DÕabord, il est
bien tabli maintenant que la BPCO entrane une inflammation locale, mais
galement systmique (Lancet 2007).
6.2.
Dnutrition
Elle est
nettement augmente chez les BPCO et elle est parallle lÕobstruction et au
pronostic (cf. index de BODE ci-dessus).
La
physiopathologie a t largement tudie et plaide en faveur de multiple
facteurs, dont notamment : une consommation nergtique accrue de prs de
20 % lÕtat stable (accrue encore par le tabagisme ou les traitements :
bta2 mimtiques), une anorexie et une dnutrition favorise par lÕinflammation
systmique, rle de la leptine, etc.
6.3.
Anmie
Un lien
important, indpendant, existe par ailleurs entre anmie et BPCO (sous
oxygnothrapie au long cours), avec une consquence marque sur le pronostic
de ces patients (hospitalisations, dure dÕhospitalisation et mortalit) Chest
2005, Similowski et al.
La survie 3 ans
est ainsi de 24 % seulement si lÕHt < 35 %, versus 70 % lorsque
lÕhmatocrite est ³ 55 % !
Survie en
fonction de lÕhmatocrite
% dÕhmatocrite
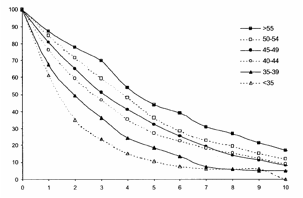 Mois
Mois
Fig.
Relation entre Hmatocrite et Survie chez les BPCO sous OLD
6.4.
Syndrome
anxio-dpressif
á
Possible
effet indpendant dÕun tat dpressif sur les exacerbations de BPCO Am J
Respir Crit Care Med, aot 2008
á La prvalence des syndromes dpressifs est
leve chez les BPCO : 9 58% Chest, oct 2008. LÕanxit est
galement particulirement frquente chez ces patients.
á
Relation
entre Dpression et BPCO : impact sur les radmissions hospitalires, sur
la qualit de vie et sur la survie : Arch Intern.Med 2007, 167
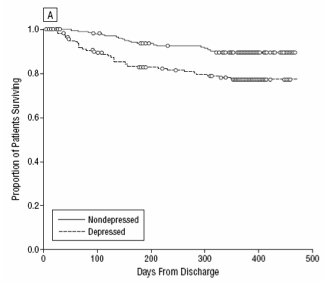
Fig. Relation entre dpression et survie chez
les patients BPCO
á Selon une rcente tude hollandaise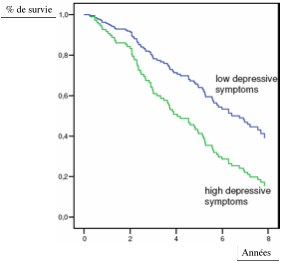 , Chest 24 nov 2008, portant sur
121 BPCO (FEV1=36,9%) avec 19,8% de dpressifs svres ou modrs, il tait
retrouv un paralllisme entre la dpression sur la survie de ces patients.
, Chest 24 nov 2008, portant sur
121 BPCO (FEV1=36,9%) avec 19,8% de dpressifs svres ou modrs, il tait
retrouv un paralllisme entre la dpression sur la survie de ces patients.
A.
6.5.
Ostoporose
Elle touche 20
30 % de lÕensemble des BPCO.
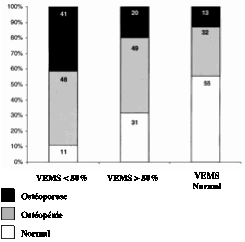 Il existe une corrlation nette entre le
degr dÕobstruction de la BPCO et lÕimportance de lÕostopnie et de
lÕostoporose.
Il existe une corrlation nette entre le
degr dÕobstruction de la BPCO et lÕimportance de lÕostopnie et de
lÕostoporose.
Am.J.Respir.Ccrit.CareMedicine, 2004 ; 170
L encore, de multiples
facteurs contribuent cette ostoporose : inflammation systmique,
hypogonadisme, corticothrapie, tabagisme, dconditionnement, dnutrition,
etc. Eur Respir J; 2003; 22; suppl.46: 64s-75s.
A contrario, il
existe un impact de lÕostoporose sur la fonction respiratoire et sur
lÕautonomie.
LÕostoporose est
donc certainement dpister chez ces patients et prendre en charge. De mme,
on vitera autant que faire ce peu, lÕutilisation de corticodes systmiques.
6.6.
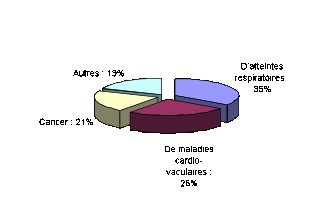 BPCO : facteur de risque cardio-vasculaire
BPCO : facteur de risque cardio-vasculaire
á Globalement, les BPCO meurent en priorit
dÕaffections cardio-vasculaires.
á Les BPCO modres svres meurent :
Etude TORCH,
2007 Thorax
á
La
BPCO est un FdR cardiovasculaire multiple. Selon une tude publie dans
lÕAnn Epidemiol 2006;16:63, sur 11 493 patients BPCO compars 22 986 non
BPCO
á Odd ratios si BPCO :
o
Arrhythmie
1.76 (CI: 1.64–1.89)
o
Angor
1.61 (CI: 1.47–1.76)
o
Infarctus
du myocarde 1.61 (CI: 1.43–1.81)
o
Insuffisance
cardiaque 3.84(CI: 3.56–4.14)
o
AVC
1.11 (CI: 1.02–1.21)
o
Embolie
pulmonaire 5.46 (CI: 4.25–7.02)
o
Mortalit
CV 2.07 (CI: 1.82–2.36)
o
Toute
cause de dcs 2.82 (CI: 2.61–3.05).
á La CRP est un marqueur prdictif du risque
cardio-vasculaire (Ridker et al). N Engl J Med 2002).
á La CRP serait implique dans la formation
de la plaque dÕathrome (Bhatt et al. Circulation 2002)
á La circulation systmique de cette
protine augmente chez les BPCO.
á La fonction respiratoire (association
retrouve dans plus de 20 tudes
prospectives) est corrle la morbidit cardio-vasculaire. Et ceci
indpendamment du tabagisme !
á Ç Une diminution mme modeste du flux
expiratoire augmente le risque de pathologie cardiaque ischmique, dÕangor et
de mort subite dÕun facteur 2 3, indpendamment des autres facteurs de
risque È ! Sin et Man.
Circulation 2003
á Le risque cardio-vasculaire augmente avec
le taux de CRP (en dosage ultra sensible), mais galement avec le degr
dÕobstruction. Cette corrlation est retrouve ds lÕapparition dÕune
obstruction modre.
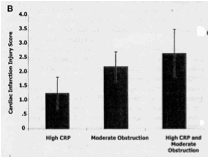
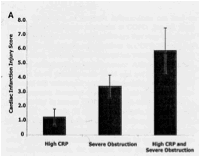
Sin et Man. Circulation 2003
á LÕinflammation systmique (CRP, IL6, TNFÉ)
est ainsi un point commun lÕartriosclrose et la BPCO.
á Les FdR sont par ailleurs intriqus :
tabagisme, obsit, vieillissementÉ
6.7.
Le
bilan respiratoire, doit donc sÕassocier un bilan
á Nutritif
á Cardio-vasculaire (avec recherche de
cofacteurs de risque)
á Musculaire (dysfonction musculaire –
dconditionnement)
á Psychologique (recherche de syndrome
anxio-dpressif)
á Hmatologique : recherche dÕune
anmie
á Rechercher une frquente dysfonction
rectile, une pathologie buccodentaire, etc.
7.
Prise
en charge des BPCO : Actualits
Les objectifs
actuels ont t rcemment prciss :
á Limiter le dclin de la fonction
respiratoire : VEMS
á Amliorer la Qualit de vie
á Amliorer la Survie
Les cibles
prioritaires sont :
á Sevrage tabagique
á Agir sur lÕobstruction bronchique
progressive et ses consquences
á Limiter la dgradation de la Qualit de
vie (autonomie, etc.)
á Limiter les exacerbations
7.1.
Le Sevrage
tabagique
Elment majeur de la prise en charge, depuis les travaux de Fletcher et
Peto en 1977 :
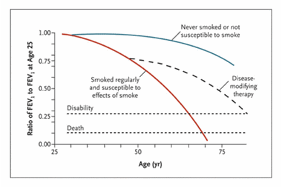
Nanmoins, le bnfice en termes de fonction respiratoire est surtout
important lorsque la limitation du dbit arien reste modre. Le sevrage
tardif, toujours ncessaire, limitera plutt la dgradation rapide.
Comme le montre cette vaste tude publie en 2001 (Am.J.RespirCrit.CareMed.
Lung Health Study) :
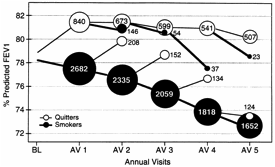
7.2.
Prise
en charge lÕtat stable
7.2.1. Bronchodilatateurs: β2 &
Anticholinergique
á Semblent avoir un effet bnfique
á β2 longue dure dÕaction > courte
dure dÕaction
á Intrt du tiotropium (Spirivaª)
á Diminution des exacerbations & de
lÕhyperinflation
ERJ 2007, Cochrane Database Syst Rev 2002
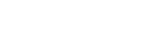
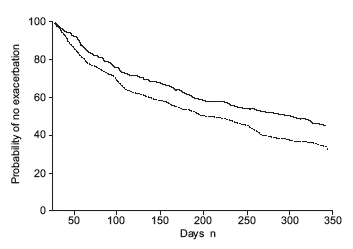
Etude MISTRAL ; ERJ 2006
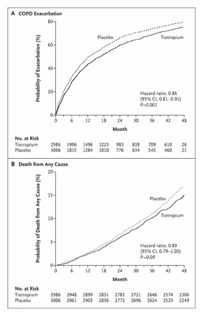 Une importante tude rcente publie dans NEJM
[2008;359:1543-54], retrouvait chez les BPCO trait par tiotropium, versus
placebo (tude en double aveugle, multicentrique) sur un suivi de 4 annes
: moins dÕarrt thrapeutique, de meilleurs paramtres ventilatoires, moins
dÕexacerbations et une meilleure qualit de
Une importante tude rcente publie dans NEJM
[2008;359:1543-54], retrouvait chez les BPCO trait par tiotropium, versus
placebo (tude en double aveugle, multicentrique) sur un suivi de 4 annes
: moins dÕarrt thrapeutique, de meilleurs paramtres ventilatoires, moins
dÕexacerbations et une meilleure qualit de  vie.
vie.
A contrario, une
mta analyse, publie galement en 2008, dans le JAMA, retrouvait un risque
dÕvnements graves cardio-vasculaires accru, versus placebo, lors de prises
dÕanticholinergiques inhals, notamment pour les courtes dures dÕaction
(ipratropium), sans impact sur la survie globalement.
Cette mta
analyse a t largement critique quand sa mthodologie.
7.2.2. Corticodes inhals + b2.longue dure dÕaction (LABA)
Selon lÕtude
TRISTAN Lancet 2003 :
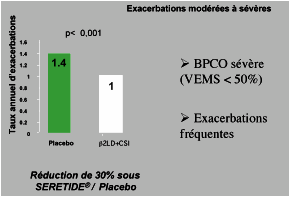 Les BPCO svres (VEMS < 50% de la
thorique), qui ont par ailleurs des exacerbations frquentes (> 2 /an)
auraient moins dÕexacerbation (baisse de 30%) sous une association inhale de
corticodes et de b2-longue
dure dÕaction.
Les BPCO svres (VEMS < 50% de la
thorique), qui ont par ailleurs des exacerbations frquentes (> 2 /an)
auraient moins dÕexacerbation (baisse de 30%) sous une association inhale de
corticodes et de b2-longue
dure dÕaction.
Pour tenter de
dmontrer un effet sur la survie, une vaste tude multicentrique TORCH, a t
publie dans le NEJM, en 2007 : 6 112 BPCO suivis pendant 3
ans, rpartis en 4 groupes selon le traitement inhal : soit un placebo,
soit un corticode inhal [fluticasone], soit un b2-longue dure dÕaction [salmtrol], soit
une forme combine des 2 [Srtideª]. Elle retrouve :
á Pas dÕeffet significatif sur la survie,
quelque soit le traitement inhal.
á Une moindre dgradation des EFR (VEMS),
sous traitement combin en particulier, mais galement sous chaque traitement
seul (corticode ou b2-longue
dure dÕaction).
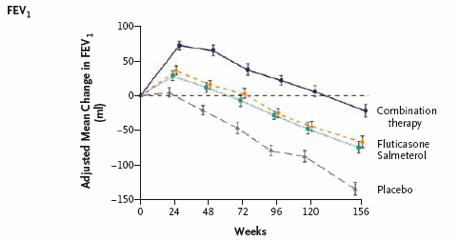
á Une frquence moindre des exacerbations
sous traitement combin.
á Un plus grand nombre de pneumonies sous
corticodes seuls ou combins.
Enfin, une rcente mta analyse publie en novembre 2008 dans le JAMA
sur 11 larges tudes (dont TORCH), ayant tudies 14 426 patients atteints
de BPCO retrouve :
á Pas dÕeffet significatif sur la mortalit.
á Majoration du risque de pneumonie :
RR = 1,34, sous corticodes inhals versus placebo.
7.2.3. N-Acetyl-Cystine (NAC)
La N-Actyl
Cystine a un effet antioxydant dans certaines pathologies, dont lÕeffet
bnfique ventuel chez les BPCO a t test :
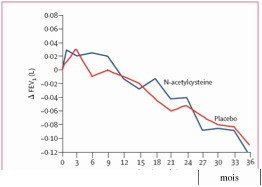 523 patients BPCO ont t traits dans
cette tude publie dans le Lancet en
2005 par Decramer et coll., par
600 mg de NAC/j versus placebo
523 patients BPCO ont t traits dans
cette tude publie dans le Lancet en
2005 par Decramer et coll., par
600 mg de NAC/j versus placebo
Aucun impact
significatif nÕa t retrouv sur la fonction respiratoire des patients.
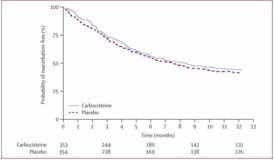 Une autre tude, chinoise, randomise,
multicentrique (22), galement publie dans le Lancet ; sur 702
BPCO, traits avec 1500 mg de NAC sur 1 an.
Une autre tude, chinoise, randomise,
multicentrique (22), galement publie dans le Lancet ; sur 702
BPCO, traits avec 1500 mg de NAC sur 1 an.
Il a t not,
439 exacerbations sous placebo versus 325 seulement dans le groupe NAC
(p=0.004), soit une baisse de 25 %.
Diffrence
significative, mais curieusement trs peu de dcs avec 91 patients sortis de
lÕtude ? La mthodologie et les conclusions de cette tude ont t assez
largement critiques.
A ce jour, les
mucolytiques restent non recommands chez les BPCO, car sÕils fluidifient
effectivement les secrtions, ils augmentent par contre leurs volumes et
peuvent majorer lÕencombrement.
7.2.4. Oxygnothrapie
Ici rien de neuf,
on sait que lÕoxygnothrapie un effet bnfique sur la survie au long court
si elle repose sur des indications prcises et une dure quotidienne dÕau
moins 15h/24h. Indication :
Hypoxmie profonde avec 2 mesures plus de 15
jours dÕintervalle, lÕtat stable, avec une PaO2 ² 55 mmHg (ou < 60 et avec une HTAP)
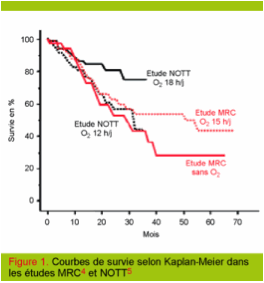
7.2.5. Traitement des co-morbidits
á Les statines (?)
á Traitement de lÕostoporose
á Traitement de lÕanmie ?
á Traitement dÕun syndrome dÕapne du
sommeil (SAOS)
á Traitement de la dnutrition
á Antibio-prophylaxie ? Macrolides,
Fluoroquinolones ?
á É
7.2.6. La rhabilitation respiratoire
CÕest un
programme de prise en charge multi disciplinaire des insuffisants
respiratoires : entranement des muscles priphriques principalement,
sous contrle mdical, mais galement kinsithrapie respiratoire, renutrition,
sevrage tabagique, prise en charge psychologique et sociale si besoin.
Ses rsultats,
avec un niveau de preuve scientifique fort, sont :
á Une plus grande capacit dÕexercice
á Un moindre essoufflement
á Une meilleure qualit de vie
á Un moindre recours aux services dÕurgences
et aux hospitalisations
7.3.
Prise
en charge des accs dÕinsuffisance respiratoire aigu
7.3.1. Dfinition
á Exacerbation = majoration des symptmes (dyspne, toux, volume
et/ou purulence des expectorations)
á Dcompensation = pronostic vital potentiellement en jeu
7.3.2. Les dcompensations
Elles reprsentent
20 % des hospitalisations en Ranimation et 15 20 % des dcs, dans ces
units selon CUB ra 1997. Elles reprsentent la 5me cause
de dcs en France.
LÕge et les frquentes
co-morbidits y jouent un rle important.
La majorit des
dcompensations sont traites en ambulatoire. CÕest le cas si :
á Risque faible de dcompensation grave
á Pas de dgradation rapide ou majeure par
rapport lÕtat de base
á Environnement familial, mdical,
paramdical et technique adapt
Risque important
de dcompensation grave :
á Maladie de fond svre
o
BPCO
stade III ou IV
o
ge
> 70 ans
o
co-morbidit
: cardiaque, obsit morbide, etc.
á Dnutrition (poids < 85 % idal)
á 3 exacerbations par an
á Confinement domicile
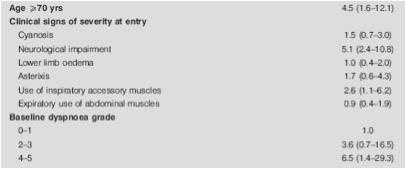 Une tude publie en octobre 2008 dans
ERJ [794 patients, sur 103 centres hospitaliers franais] note comme
facteurs de risque de dcompensation grave : lÕge ³ 70 ans, une discrte somnolence ou des
troubles de la vigilance, lÕimportance de la dyspne, lÕutilisation de muscles
inspiratoires accessoires (cf. Tableau).
Une tude publie en octobre 2008 dans
ERJ [794 patients, sur 103 centres hospitaliers franais] note comme
facteurs de risque de dcompensation grave : lÕge ³ 70 ans, une discrte somnolence ou des
troubles de la vigilance, lÕimportance de la dyspne, lÕutilisation de muscles
inspiratoires accessoires (cf. Tableau).
![]()
7.3.3. TRAITEMENT DES ACCES
7.3.3.1. Oxygnothrapie
€
Si
sous air, SpO2 < 90%
¥
O2
impratif 0,5 2
l/min
€
But
SpO2 entre 90 et 95% maximum ++
¥
Contrle
par Gaz du Sang (ATTENTION la
PCO2)
¥
Surveillance
clinique (somnolence, etc.)
7.3.3.2. Bronchodilatateurs
Efficace sur les
symptmes fonctionnels : dyspne, distension
€ Bta-2-mimtiques et/ou anticholinergiques :
€ efficacit quivalente
€ effet additif, non dmontr
€ pas dÕeffet dmontr sur la survie
Selon les
recommandations de la Socit de Pneumologie de Langue Franaise
(SPLF) datant de 2003
€ En ambulatoire : arosols non recommands
€ A lÕhpital : bta2-mimtique en 1re
intention (inhalation +/- arosols)
€ Adjonction dÕun anti-cholinergique si
inefficace
€ Si inefficace : rvaluer (
Ra ? )
€ Si salbutamol IVSE => Scope : Soins
Intensifs/Ra
7.3.3.3. Corticodes systmiques
Intressant si
rversibilit aux EFR ou une histoire compatible avec un asthme mais ATTENTION
si il existe une infection
Toujours selon
les recommandations de la SPLF 2003 :
á Bnfice marginal dans certains sous
groupes de patients de BPCO svres
á Modalits : Dose : 0,5 mg/kg/j
pour quelques jours (< 10 jours)
7.3.3.4. Corticodes Inhals
á Moins dÕeffets secondaires, mais bnfice ?
á Plus prescrit dans la BPCO que dans lÕasthme ? ? !
7.3.3.5. Kin Respiratoire
á Dsencombrement au cours des exacerbations
á
Prudence
lors des dcompensations (risques dÕpuisement) SPLF 2003
7.3.3.6. Antibiotiques
A)
Ils
ne sont Ç pas automatiques È !
Depuis lÕtude dÕAnthonisen
de 1987, ils restent indiqus en cas de majoration de 2 symptmes
parmi :
á La dyspne
á Le volume et/ou la purulence des crachats
Ou bien sr en
cas de pneumonie vraie.
Les germes en
causes dans les accs de BPCO sont rapports dans la table ci-dessous, publie
rcemment, en novembre 2008, dans le NEJM par Sethi et coll.
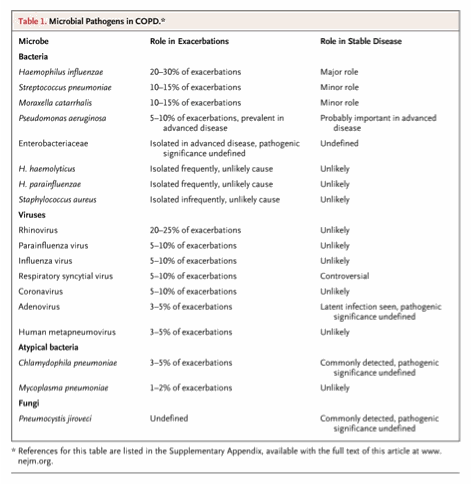
Outres les causes
virales (notamment le rhinovirus), lÕHemophilus,
la Moraxella (ex Branhamella catarrhalis) ou le pneumocoque sont les germes les plus
frquemment retrouvs.
On se mfiera
dÕun pyocyanique, en cas de rsistance une antibiothrapie de premire
intention, dont le traitement de rfrence reste Fortumª + aminoside IV.
Le rle
dfavorable des exacerbations infectieuses, dans lÕvolution de la maladie
respiratoire, est bien connu aujourdÕhui et dtaill dans cette revue du NEJM.
B)
Quel
antibiotique choisir ?
Selon la Mta
analyse publie par Siempos et coll. Dans lÕERJ 2007;29:1127-37 :
á Il nÕy aurait pas de diffrence entre
Macrolides, F-Quinolones et Augmentinª dans les exacerbations de BPCO.
á Il y aurait possiblement, moins de
rcidives avec les fluoroquinolones ? Mais ceux-ci posent des problmes pour
lÕcologie bactrienne et les sujets gs et ils ne doivent pas tre utiliss
avec un intervalle de moins de 3 mois.
Selon les
recommandations de la Socit de Pathologie Infectieuse de Langue Franaise
(SPILF) en collaboration notamment avec la SPLF, publies en 2006 sur la Prise
en charge des infections des voies respiratoires basses de lÕadulte
immunocomptent :
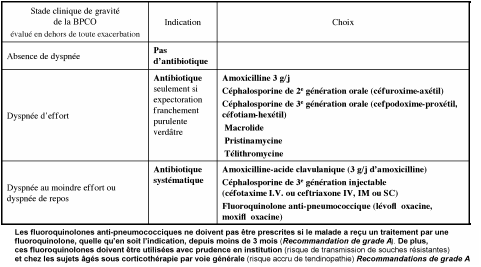
¥
Ne
pas utiliser les cphalosporines orales dans les formes graves dÕexacerbation
de BPCO (mauvaise diffusion dans le parenchyme pulmonaire)
¥
EFR
raliser systmatiquement, distance de lÕexacerbation, pour affiner les
critres de prescription pour les pisodes ultrieurs
¥
Dure
de traitement
– 5 jours dans les formes peu svres (stade
2) [Accord professionnel]
– 7 10 jours maximum dans certains cas
svres [Recommandation de grade A]
¥
En
cas dÕchec, faire un ECBC et une radio de thorax.
LÕECBC pour adapter ventuellement lÕantibiothrapie en cas de modification de
la flore bactrienne avec notamment prsence de Pseudomonas.
7.3.3.7. Autres traitements
á test aux diurtiques (?)
á anticoagulants (?)
á contrle glycmique stricte (?)
LÕhyperglycmie
aggrave en effet le pronostic des exacerbations de BPCO. CÕest par le constat
effectu par lÕtude publie en 2006 dans Thorax par Baker et
coll., qui retrouve un risque dÕvolution plus dfavorable de 15% pour
chaque mmol/l de glycmie en plus.
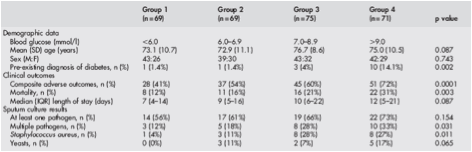
á Thophylline Pas dÕindication
á Mucomodificateurs Pas dÕindication
á Analeptiques respiratoires Pas dÕindication
á Antitussifs Contre-indiqus
á Psychotrope, sdatif Contre-indiqus
7.3.3.8. Ventilation Non Invasive (VNI) +++
Dveloppe depuis les annes 90, cette
thrapeutique effectue par des quipes spcialises, a vritablement rvolutionne la prise en
charge de ces patients en dcompensations. De multiples tudes bien conduites,
multicentriques [preuve de niveau 1] ont montr que la VNI :
á rduit la mortalit (en ranimation et
lÕhpital)
á rduit les dures de sjour
á rduit la morbidit
á conomie majeure
De ce fait, selon
les recommandations nationales et internationales, la VNI doit pouvoir tre
propose tout patient souffrant dÕune dcompensation de BPCO !
(un ranimateur doit tre prsent dans
lÕtablissement de sant)
8.
Perspectives
Thrapeutiques
Elles sont
nombreuses. Selon une revue rcente publie en dcembre 2008 par Peter
Barnes dans Proc Am Thorac. Society, sont notamment listes :
á
La
Voie inhale : elle pourrait encore se dvelopper, permettant la fois une
bonne efficacit, tout en limitant les effets secondaires. Elle est lÕtude
pour : PDE4 (phosphodiestrase 4) ? MAPK (p38 mitogen-activated protein
kinase inhibitors) ? NFκB ? Statines ?É
á Les Statines, qui auraient un effet
antioxydant, immuno-modulateur et un effet anti-inflammatoire intressent chez
les BPCO et qui pourraient limiter lÕinflammation systmique dont le rle a t
voqu plus haut.
á Les Inhibiteurs de lÕenzyme de conversion
avec un rle sur lÕHTAP, la distension et lÕinflammation, qui reste prciser.
á LÕagoniste du PPAR (peroxisome proliferator–activated
receptors) avec un rle sur lÕhomostasie nergtique, le mtabolisme et
lÕinflammation.
á LÕ anti TNF-α, lÕIL6, ou lÕanti-CRP
á Les antioxydants, dont les activateurs du
nuclear factor erythroid-2–related factor 2 activators,
á Les anti-vieillissements comme la
sirtuin 1 agonists, pourraient avoir un rle de mme que sur la prvention
dÕune cancrogense.
